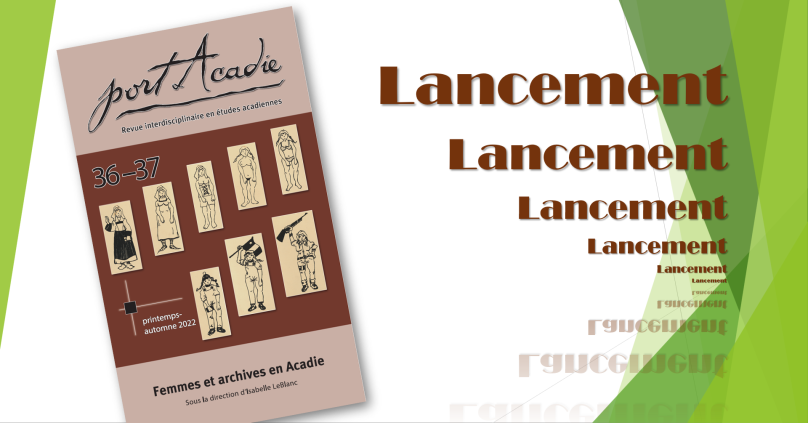Le dimanche 10 septembre, à 14h00 (Atlantique), la revue Port Acadie célébrera la sortie d’un numéro double consacré au thème des « Femmes et archives en Acadie », sous la direction d’Isabelle LeBlanc, professeure adjointe au Département d’études françaises de l’Université de Moncton, et en collaboration avec le Groupe de recherche sur les archives et les femmes en Acadie, ou GRAFA. Le lancement aura lieu dans les locaux de l’Observatoire Nord/Sud de l’Université Sainte-Anne (2e étage de la Bibliothèque Louis-R.-Comeau) et sera également diffusée sur Zoom (LIEN ICI). Tout le monde est invité !
Ce double numéro thématique réunit 13 articles scientifiques, relevant de plusieurs disciplines dont l’histoire, la sociolinguistique, le folklore et les études littéraire, en plus d’une introduction signée par Isabelle LeBlanc. Celle-ci explique que le fil conducteur de cette publication consiste à sortir les femmes de l’invisibilité dans laquelle elles ont été traditionnellement confinées, et ce, « afin de mieux appréhender la place des récits individuels dans notre compréhension du monde social ». Il s’agit d’un tournant marquant et prometteur en études acadiennes.
Fondée en 2001, la revue Port Acadie se veut un havre qui accueille différentes perspectives en études acadiennes, dans toutes les disciplines et dans toute leur diversité. Elle est dirigée par Clint Bruce, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales, et son comité de rédaction est composé de Susan Knutson, Chantal White, Tania Grégoire et Judith Patouma.
TABLE DES MATIÈRES – Port Acadie, nos 36-37 (printemps-automne 2022),
Introduction – « Femmes et archives en Acadie : valoriser les traces matérielles de femmes dans une perspective interdisciplinaire et bilingue », Isabelle LeBlanc
Partie 1 – Femmes et archives : construction et traitement à partir des collections acadiennes
- « Femmes et archives : une approche auto-ethnographique », Phyllis LeBlanc
- « Invisible dans l’histoire : réflexions sur les femmes acadiennes dans les collections du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson et du Musée acadien de l’Université de Moncton », Estelle Dupuis, Jeanne-Mance Cormier et Christine Dupuis
- « “ Dans ce temps-là […] les petites filles n’avaient pas le droit de faire comme les petits garçons” : analyse genrée des archives de folklore du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, Mathieu T. Martin
Partie 2 – Affects et intersubjectivité dans les archives de femmes en Acadie
- « Le travail domestique, les recettes et la reproduction de l’identité ethnique acadienne », Katie K. MacLeod
- « Féminisation d’un discours public sur la langue à Moncton entre 1947-1965 : les traces archivistiques d’une honte linguistique », Isabelle LeBlanc
- « Incarner les récits de la Boîte aux lettres : mettre en oeuvre des archives personnelles pour se raconter », Eugénie Tessier
- « DÉ-GÉNÉRATION-ELLES — trauma et transmission intergénérationnelle : un projet photographique artistique à partir des archives des rescapées du génocide arménien », Lucia Choulakian
Partie 3 – Traces littéraires et sources mémorielles de femmes au Canada
- « Hétérogénéité, transgressions et hospitalité. Des frontières de l’étrange(r) chez Antonine Maillet », Corina Crainic
- « De Sillery à l’Acadie : la trajectoire de l’écrivaine acadienne Huguette Légaré. Poèmes de jeunesse et lettres de sa mère », Benoit Doyon-Gosselin et Isabelle Blais
- « Female Authorship, Incomplete Archives, and the Periodical Press in Nineteenth-Century Montreal: The Case of Rosanna Mullins Leprohon », Andrea Cabajsky
Partie 4 – Relations sociales et parcours migratoires de femmes (18e-20e siècles)
- « Les mondes enfouis d’Anne Suzanne Richard. Une marge d’autonomisation féminine après la Déportation (1785-1789) », Adeline Vasquez-Parra
- « Vers une reconstitution de la mobilité des Acadiennes à l’époque de l’industrialisation : l’émigration familiale et l’exode rural vus à travers l’analyse longitudinale », Lauraly Deschambault, Noémie Haché-Chiasson et Gregory Kennedy
- « Les Acadiennes louisianaises de la Société du Sacré-Coeur de Jésus, entre interculturalité et mobilité interrégionale », Clint Bruce